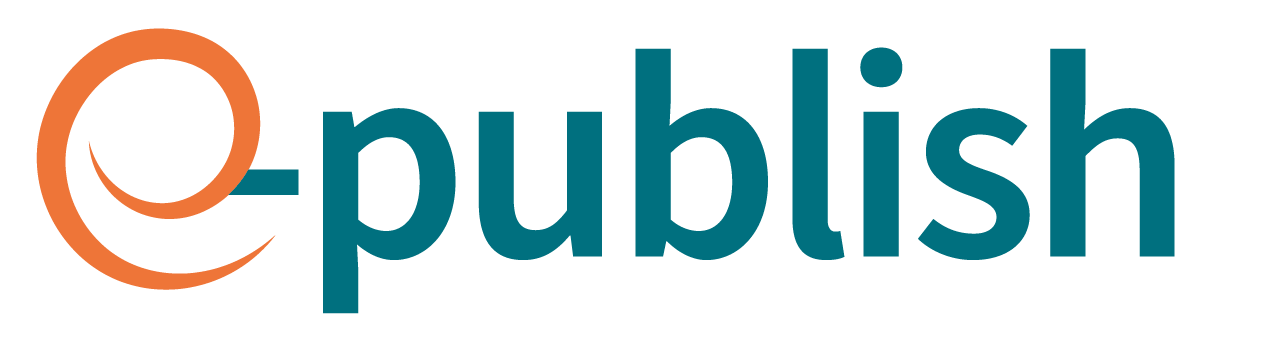Le numérique
Le livre imprimé existe depuis le milieu du XVe siècle. Le livre numérique a déjà plus d’un demi-siècle. Le premier livre numérique, la première réalisation du projet Gutenberg (le « eText #1 ») de création de versions électroniques gratuites d’œuvres littéraires, a été produit en 1971.
« Au XVIe siècle, Gutenberg a permis à chacun d’avoir quelques livres. Au XXIe siècle, le Projet Gutenberg permettrait à chacun de disposer d’une bibliothèque gratuite. L’arrivée d’Internet en 1974, puis du World Wide Web en 1990, a fait de ce projet une réalité » (Lebert, 2016).
De quoi parle-t-on ?
Alors que l’édition traditionnelle se concentre sur la qualité esthétique du document et de la page imprimée, l’édition numérique va plutôt se concentrer sur la qualité des fichiers utilisés pour la publication dans ses différents formats. Avec l’édition numérique, le travail sur le fond et le travail sur la forme sont clairement distincts.
Pour s’adapter aux nouveaux modes de consultation (à l’écran essentiellement), l’édition numérique doit produire des fichiers de type html (des pages web) et ePub[1] (créés spécifiquement pour les liseuses électroniques).
Néanmoins, alors que les formats html et ePub s’adaptent aux dimensions des appareils, le format pdf[2], paginé[3], est peu adapté à la lecture à l’écran mais reste néanmoins le format privilégié pour le monde scientifique. Il est surtout réservé à l’impression (impression individuelle ou impression de livres et de revues).
Ce changement de point focal (qualité des fichiers) permet de proposer des processus plus ouverts. Ils sont basés sur les principes de l’édition à source unique (Single Source Publishing[4]), c’est-à-dire l’utilisation d’un fichier unique (ou un ensemble de fichiers) pour produire un même contenu dans différents formats. Markdown, utilisé avec Pandoc et LaTeX, est particulièrement approprié pour l’édition à source unique.
La démarche de la publication numérique consiste dès lors à remplacer une pseudo-structuration esthétique par manipulation des attributs typographiques (majuscules, tailles, gras, italiques, soulignés ou styles aléatoires des traitements de texte pour signifier la structure d’un texte) par une structuration sémantique stricte permettant aux logiciels utilisés de « comprendre » la structure d’un texte et de la répercuter esthétiquement et fonctionnellement.
Produire un document pdf avec un traitement de texte (Word) ou avec un logiciel de mise en page (InDesign) n’est donc pas de l’édition numérique.
Il faut par ailleurs considérer que l’édition numérique et le web sont liés. D’un point de vue technique, leurs langages de programmation sont identiques, et au niveau de leurs procédés de conception, leurs workflows sont comparables (Usclat, 2017).
Parce que l’édition numérique a remodelé la chaîne éditoriale traditionnelle, permettant une structuration des contenus pour des formes de diffusion multiples, et non plus simplement pour un livre imprimé, l’édition numérique a transformé le rôle de l’éditeur.
Les éditeurs, qui restent les garants de la validité des contenus et de la qualité esthétique des documents produits, doivent progressivement envisager tous les aspects techniques de la publication (indexation, liens hypertextes, espaces de communication et multimédia) et organiser leur production et leur diffusion pour plusieurs formats.
Ils sont par ailleurs amenés à travailler plus étroitement avec les auteurs pour les aider à comprendre les possibilités offertes par la publication numérique et les intégrer dans le travail de création. Ils doivent dès lors apprendre à mobiliser de nouvelles compétences qui ne faisaient pas partie de leurs savoir-faire traditionnels.
Cette évolution impose une réflexion sur la mission et la place de l’éditeur dans le panorama numérique (Boismenu & Beaudry, 2002 ; Dufrasne, 2024 ; Epron & Vitali Rosati, 2018).
Le plus souvent, les éditeurs s’associent à d’autres prestataires (dont les bibliothèques et les spécialistes du web) pour faire le grand saut du numérique.
L’édition numérique ouverte dans la démarche académique
L’édition numérique est un des fondements sur lequel repose le modèle du libre accès. Elle facilite une diffusion plus large et plus rapide des connaissances scientifiques tout en respectant les droits d’auteur. Ce rapport entre les deux est essentiel pour promouvoir une science ouverte et accessible à tous.
L’édition scientifique est soumise à plusieurs contraintes. Fauchier et al. (2022) ont listé les éléments indispensables à retenir :
- l’appareil critique : notes de bas de page, citations, bibliographies, figures, encarts, etc. ;
- les métadonnées : données sur les données, comme le titre, le sous-titre, les auteurs, les identifiants standards (ORCID, Wikidata, etc.) ;
- la structuration du texte : la structuration sémantique des textes est une nécessité pour la diffusion numérique ;
- les données bibliographiques : avec des références structurées ;
- des formats spécifiques : articles, livres, actes de conférence, etc. ;
- l’évaluation par les pairs : une circulation et une validation complexes des textes ;
- le rejet du modèle publish or perish : publier beaucoup mais lentement.
L’utilisation de fichiers au format « texte », balisés avec Markdown et transformés avec Pandoc, repose sur le principe de l’édition numérique ouverte et va rencontrer ces contraintes.
- Un fichier ePub est constitué d’un ensemble de pages html regroupées dans un fichier compressé. ↵
- Le format pdf (Portable Document Format) est un langage de description de page créé par Adobe en 1992. En 2008, c’est devenu un format ouvert (norme ISO 32000-1:2008). ↵
- Pour un document au format pdf, le découpage en pages est figé alors que pour un document numérique, au format ePub, le découpage varie en fonction des options d'affichage. ↵
- https://ssp.digitaltextualities.ca/ ↵