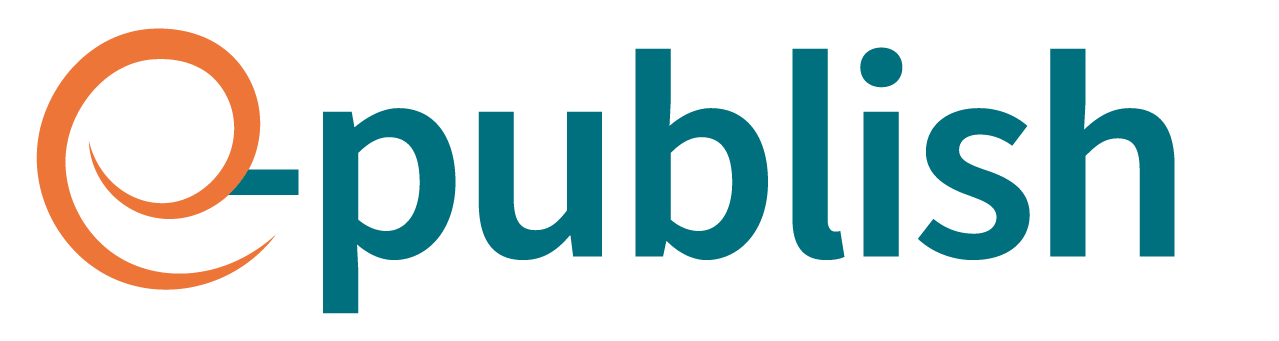13b. Une haie rempart
Certains jardins sont un poème, d’autres une comédie grotesque, caricaturale au point d’en être risible. Ils ne donnent guère envie d’entrer dans la tête de ceux qui les ont aménagés et y demeurent. Même si, on l’imagine, eux s’y complaisent.
Au hasard de mes randonnées, je croise régulièrement ces panonceaux qui me laissent toujours un peu rêveur : « Je monte la garde. » Cette fois-ci, je n’en comprends vraiment pas l’utilité tant tout le contexte est explicite. Un pavillon cubique, des années septante ou quatre-vingt, entouré d’une haie rectangulaire de thuyas, bien dense, bien épaisse, bien opaque, bien haute. Elle est elle-même ceinturée d’un grillage aussi haut qu’elle, qui la double. Entre les deux, la terre est nue, raclée par les allers et venues constantes de deux dobermans, bondissants et hurlants. Fallait-il vraiment signaler qu’ils montent la garde ?
Pour compléter le tableau, il ne manque ni la grille métallique qui s’ouvre avec une télécommande, à laquelle est accolée une ampoule qui clignote au moment de l’ouverture et de la fermeture, ni la caméra de surveillance, pour le cas où les chiens n’auraient pas rempli leur rôle. Deux précautions valent mieux qu’une, et vingt que dix.
Derrière la grille, je devine le chemin, bien net, qui mène en ligne droite jusqu’à la porte, la pelouse bien tondue et l’absence de toute fleur, comme de tout autre végétal que du gazon. Par contre, personne ne s’attarde dans ce jardin, tant il doit être oppressant. Le propriétaire a d’autres chats à fouetter…
On dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître. Que dire des jardins ? Celui-ci est emblématique. Ne voyant pas le maître des lieux, je ne peux que l’imaginer. Un homme, d’un certain âge, aigri et grinçant, en guerre avec le monde entier, et pour qui le mot réactionnaire serait presque doux. J’aimerais me tromper, mais son jardin est tellement explicite…
Où est la limite entre soi et le monde ? Entre soi et les autres ? À la surface de la peau ? Aux murs de la maison ? À la haie du jardin ? Au bout de la rue ? À la frontière du pays ?… Toutes ces lignes sont révélatrices d’une manière d’être présent au monde et de l’accueillir, ou de s’en protéger. Tous, nous les esquissons, consciemment ou inconsciemment, seuls ou collectivement. Elles prennent à chaque fois une autre forme, génèrent un autre espace, manifestent un autre imaginaire.
Cet imaginaire-ci est effrayant. Il ne voit le monde qu’hostile, en l’autre qu’une menace. Est-il lucide ? Il est surtout mortifère et engendre l’hydre dont il entend se protéger. Cet imaginaire est d’autant plus terrifiant qu’il ne s’arrête pas à un jardin ou à un individu, mais se répète au cours de l’histoire et au cœur de nos sociétés.
Un monde fait de séparations, de clôtures, de remparts et de frontières hermétiquement fermées. Un beau programme politique ! Celui qui y adhère, le défend ou le promeut a-t-il conscience qu’il se met lui-même en prison, où il ne pourra qu’étouffer dans sa propre haine ? Le monde qu’il produit s’étrangle tout seul. Comment pourrions-nous vivre sinon dans la respiration entre soi et les autres ? Les exclure en fait nécessairement des ennemis.
Si une haie, par définition, est aussi une séparation, celle qui n’est que cela n’est plus une haie. Univoque, elle se nie. Une véritable haie tout à la fois sépare et réunit. Elle vit de ses trouées, qui font vivre le jardin.
Cette réflexion est certainement outrancière. Elle extrapole, en devinant dans un simple alignement de thuyas tout un univers mental et un projet de société. Ce ne sont là que quelques buissons, quelques fils de fer et deux chiens. À voir. Mais le propos est surtout dérisoire parce qu’il n’arrivera jamais à convaincre celui qui a planté ces buissons. Sa haie se veut bel et bien un rempart ; les autres sont bel et bien des ennemis. Son imaginaire colle à sa réalité, sans faille.