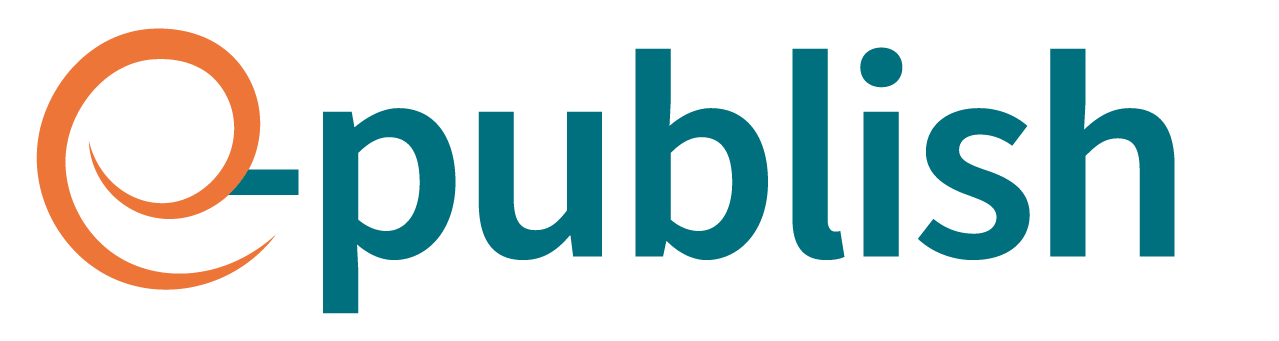16a. Au bord de l’eau
« Il faut remercier les dieux d’avoir fait passer les fleuves au milieu des villes ! »[1] aurait dit Proudhon. La formule a le charme d’une contre-vérité : l’urbanisation s’est faite le long des cours d’eau. Que reste-t-il aujourd’hui de cet accostage des villes au bord des fleuves ? Les situations sont diverses, bien entendu. Quelques modèles sont néanmoins récurrents.
Une petite ville en bord de Meuse, en amont de l’industrialisation, dont elle constitue l’un des derniers ressacs. Les quais ont été aménagés pour amarrer les péniches, les charger et les décharger, mais aussi et surtout pour contenir le fleuve. Les rives étaient marécageuses, sujettes aux inondations. Les risques semblent désormais tenus à distance.
Je quitte la ville à pied. Au fil du temps, les lotissements, les zones commerciales et, plus récemment, quelques grands immeubles d’habitation sont venus s’accoler les uns aux autres pour former un tissu urbain devenu dense. Par la force des choses, le fleuve l’interrompt. Il surgit soudain entre deux bâtiments. Me voilà, tout à coup, face à la Meuse.
Comme je franchis le rempart des bâtiments, mon regard se jette sur l’eau et aussitôt le traverse, vers l’autre rive. De prime abord, le lieu ressemble à un bassin portuaire – une surface d’eau saumâtre, dépourvue de toute translucidité, contenue entre deux quais. Ce n’est qu’ensuite, quand mes yeux partent sur la gauche et sur la droite, que cette surface se métamorphose en cours d’eau. Il faut longer la rivière pour que le regard puisse en suivre le cours.
Je marche donc le long du fleuve, sur un quai en béton de plusieurs mètres de haut, en suivant le chemin de halage, lui-même bétonné. Un quai plutôt qu’une berge – la rupture entre l’eau et la terre est abrupte. Cheminer en haut d’un mur, l’exercice est quelque peu périlleux, presque vertigineux. Il suffirait d’un coup de vent un peu violent pour être précipité dans l’eau. Les quelques promeneurs ont la prudence de rester à l’écart du bord.
Les quais n’appellent qu’à peine à la promenade. Si un petit nombre de marcheurs et de cyclistes empruntent cette voie, c’est qu’elle est horizontale et rectiligne, assez facile d’usage. Ses attraits s’arrêtent là. Non seulement dangereuses, les berges bétonnées sont dépourvues de toute végétation et de toute rive – où l’eau et la terre se toucheraient – et donnent à la Meuse l’aspect d’un simple canal.
Faire d’un cours d’eau un canal, l’industrie en a éprouvé le besoin, tout comme l’urbanisation. Les bénéfices sont certains ; le prix à payer aussi. Ici le fleuve en a perdu sinon son âme, du moins son identité. Coupé de l’ensemble du paysage, il n’est plus qu’un couloir pour la circulation fluviale. La rivière est désormais séparée de la vallée qu’elle a creusée et du relief qu’elle a dessiné, comme si elle n’appartenait plus au corps dont elle est l’artère principale. Pour des raisons fonctionnelles, on lui a ôté la possibilité d’évoluer et d’interagir avec les lieux.
Envers et contre tout, pourtant, la vie s’attache à cette eau figée. Quelques canards y nagent, des mouettes la sillonnent, quelques saules s’efforcent de pousser dans les fissures du béton. Gestes de résistance un peu dérisoires. On imagine ce qu’ont dû être ces berges autrefois – des marécages où grouillait la vie sauvage, des lieux assez hostiles, difficiles d’accès et quelquefois imprévisibles. Depuis lors, nous les avons domestiqués et asservis. Au fil des siècles, la relation des hommes aux fleuves s’est transformée et le visage des cours d’eau en a subi l’empreinte. Ici, l’industrie lourde a gagné la bataille.
Aujourd’hui, cette industrie a sonné la retraite. Nous reste son héritage. À pied ou à vélo, les promeneurs contemporains déambulent dans les vestiges de son activité. Curieux contraste, où nous nous mouvons dans le paysage d’une autre époque. Flânant au bord du fleuve, nous rencontrons surtout les ruines de son exploitation. Sous cette croûte de béton, n’est-ce pas l’esprit du fleuve qui nous enjoint de le libérer ?
Tout laisse à parier que la mobilité douce contribuera à remodeler les traits du site. On végétalisera, on retravaillera les revêtements, on fissurera davantage le béton pour rendre, au moins partiellement, ses droits à la nature, au fleuve lui-même. Un jour, peut-être, il retrouvera son lit et son propre rythme. Peut-être, ici, un jour, pourrons-nous à nouveau
Entendre au pied du saule où l’eau murmure
L’eau murmurer[2].