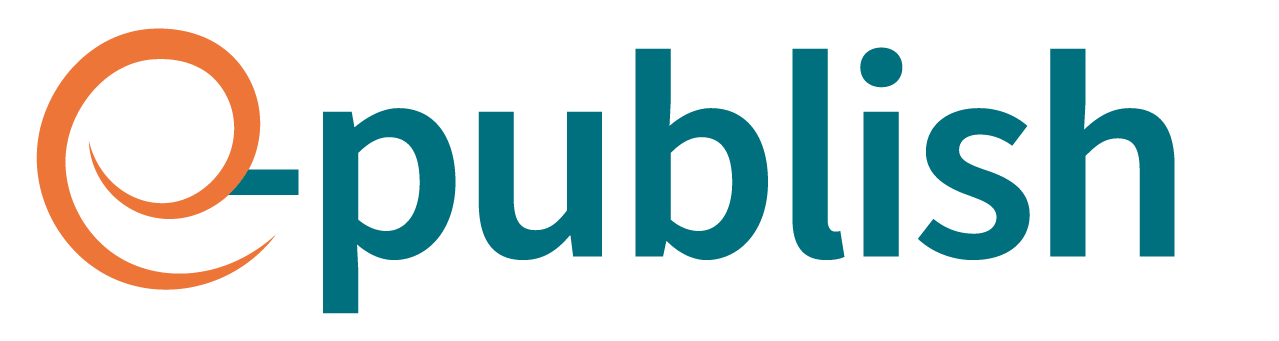1b. Le grand parking
Je quitte l’autoroute, tourne sur moi-même et, face à la cloison jaune et bleue, m’avance dans ce grand vide où les voitures s’alignent, cherche un petit vide pour y glisser la mienne. I, J ou K suffisamment proches de la sortie du magasin : il faudra retenir la lettre de l’allée dans cette uniformité bien lissée. Je sors de ma voiture et tout conduit mon regard vers l’entrée du magasin. Le lieu est rudimentaire et sa pratique élémentaire. Pourquoi s’y attarderait-on ? Tout est fait pour qu’on ne s’y attarde pas.
Atypique, je m’offre le luxe d’une analyse. Comment s’agence cet élémentaire ? L’espace est grand ouvert : sans véhicule, il serait nu. Les emplacements sont faits pour être vides, n’offrir aucun attrait qui pourrait susciter l’intérêt. Une surface bétonnée sans arbre ni buisson, sans l’ombre d’une ombre ou d’une aspérité. Seules des marques au sol et quelques blocs structurent l’espace, impérativement orienté vers le magasin. En somme, la pauvreté du lieu fait son efficacité.
Les lointains ? Qui prendrait le soin d’y prêter attention ? Le site est un grand plateau, aucun point de vue n’est significatif, le regard reste à l’horizontale et n’a aucune raison de voyager. À mi-distance, le bruit de l’autoroute, pourtant bien présent, passe inaperçu. Les seuls éléments qui pourraient attirer le regard sont les couleurs bariolées des commerces à l’autre extrême du zoning. Ils semblent toutefois bien lointains, inaccessibles à pied. Entre eux et moi, les axes de circulations paraissent infranchissables. Comme si le vide de ce parking le repliait sur lui-même. Comme si ce magasin était un îlot en mer. En regardant à l’horizon, j’aperçois bien au loin des rangées d’arbres, quelques bosquets et le quartier avoisinant. Le vide m’en sépare, bien mieux que ne ferait un mur. Il opère une distance absolue entre moi et ces là-bas.
Rien ne me protège du vent, de la pluie, de la chaleur ou du froid. Ma voiture ou le magasin sont les uniques refuges. Quant aux matières ? La texture lisse mais inhospitalière du béton, le métallique des voitures, celui des murs du magasin et le verre des sas d’entrée et de sortie. Rien de doux, rien de souple et surtout rien de vivant, hormis les autres clients – qu’il est difficile de ne pas réduire à leur rôle de client. Le sol ? Même si je marche sur lui, il est comme absent : aucune trace de terre, qui ferait sale, presque aucun relief, rien qu’une très légère inclinaison du parking dont tous les replis et les variations ont été aplanis. Manifeste, mais passant bien sûr inaperçue, est surtout l’absence d’épaisseur et de profondeur de ce « sol ». Je marche sur une surface dont il m’est impossible d’éprouver ou même d’imaginer la terre sous elle. Suis-je encore sur terre ? Ou bien plutôt hors sol ? Ou en apesanteur ?
Les couleurs ? Il y a bien sûr ce bleu et ce jaune éclatants, d’autant plus éclatants qu’ils sont complémentaires, et d’autant plus frappants que le bleu est un grand monochrome. Et puis rien d’autre… ou plutôt tout le reste est écrasé par ces deux couleurs. Il y a bien le bigarré des voitures, les variations grises du béton, les marques colorées au sol, au loin les verts de la végétation, les beiges et les bruns des quartiers voisins, mais tout cela est effacé par la grande muraille bicolore. Elle seule apparaît, renvoyant tout son contexte aux limbes de l’inapparent.
Les objets, les éléments ? Très peu de choses, dispersées au loin les unes des autres. Quelques blocs de béton au bord des allées, des réverbères trop frêles pour opposer leur verticalité à l’horizontalité du lieu, quelques chariots métalliques. Aucun siège, aucun muret où l’on pourrait s’asseoir, pas un parterre de fleurs, ni même un petit bout de pelouse. Rien n’invite à s’attarder, à se poser. Il faut entrer ou bien reprendre la voiture.
Quel est l’esprit de ce parking ? Poser la question est déjà ironique ! Tous les parkings sont équivalents ; celui-ci est emblématique. Un espace nu, démesuré et désertique, où tout s’écoule vers le commerce. Un grand accès automobile à la consommation. Que pourrions-nous faire d’autre ici que de rêver d’acheter ? Sitôt sortis de la voiture, nous avons déjà la tête dans le magasin. Rien ne nous accroche ici, notre esprit est déjà ailleurs. Sans aucun doute, ce commerce-ci, cette chaîne commerciale-ci a sa spécificité, comme toutes les chaînes commerciales… La preuve en est que chacun en parle au singulier, en l’appelant par son nom propre, comme si chaque magasin était la chaîne entière. Enlevons ce magasin, il ne subsiste qu’une grande plaque vide, un espace monofonctionnel, dont on a exclu toute autre particularité et toute autre possibilité. Rien qu’un parking.
Que reste-t-il ici de la sociologie, de l’esthétique, de la culture, de la psychologie elle-même ? Rien ou peu de choses. Sociologiquement, il faut avoir une voiture, ce qui n’est pas tout à fait négligeable. Culturellement, il faut avoir l’idée de venir ici. Manifestement, les appels sont bien orchestrés, mais ne remontent pas bien loin dans l’histoire. Il s’agit de vivre à l’heure d’aujourd’hui. Esthétiquement, nous sommes face à ce que toutes les cultures ont refusé jusqu’au XXe siècle : réduire un objet, en l’occurrence un espace, à sa stricte fonctionnalité[1]. Une esthétique de l’absence d’esthétique – d’autant plus paradoxale que la chaîne a fait du design sa marque de fabrique. Pour ce qui est de la psychologie, comment chacun pourrait-il faire sien ce lieu, se l’approprier ? Que pourrions-nous y faire d’autre que d’être un usager semblable à tous les autres usagers ? Des pratiques transgressives sont peut-être possibles, mais elles requièrent d’être très imaginatif et très transgressif.
L’esprit d’un lieu vide est le vide. Nous ne pouvons y avoir que la tête vide. Expérience mystique en certaines circonstances. Mais ici – personne ne s’y trompe –, le vide est aussitôt rempli par un imaginaire consumériste.
- LEROI-GOURHAN, André, Le geste et la parole, Tome II, Albin Michel, 1964, p. 128. ↵