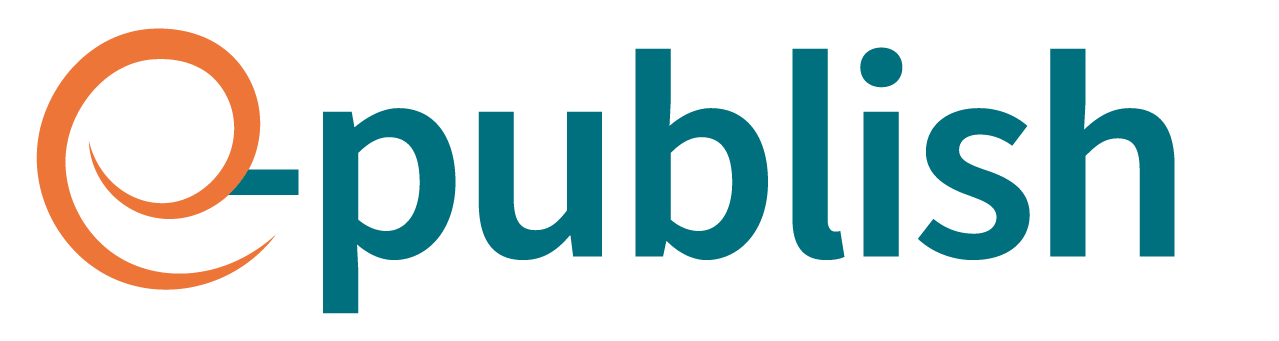2b. La cité au milieu des prés
Les blessures sociales sont toujours purulentes et les logements sociaux, bien souvent de piètres pansements.
À deux-trois kilomètres du bourg, en bordure du plateau agricole, me voici dans cette petite cité. Quelques dizaines de pavillons – trois ou quatre façades avec jardin – forment un lotissement. Derrière eux, trois immeubles, d’une dizaine d’étages, surgissent inopinément. Jaillissant de nulle part, que font-ils là ? On ne peut les manquer. Ils crèvent les yeux. On les voit à des kilomètres. Deux grands parallélépipèdes grisâtres tranchant sur l’horizon, d’une rigidité sépulcrale dans ce contexte rural. Non seulement leur silhouette est incongrue, mais le grain de leur béton, froid et uniforme, heurte mon regard, qui s’écrase sur lui. À distance, des couleurs censées égayer les murs s’avèrent illusoires et virent au gris. Comble de disgrâce, de grandes antennes paraboliques chapeautent ces blocs, elles aussi visibles de loin.
Non contents d’avoir planté ces deux immeubles dans la campagne, les urbanistes ont eu l’idée de répandre du macadam tout autour : des parkings, une esplanade, un terrain de sport… Bien entendu, il reste quelques trous d’où les plantations, courageusement, s’efforcent d’émerger bon gré mal gré. Accoler du béton à du béton, quelle intuition ! Ainsi les riverains ne saliront pas leurs chaussures en allant de leur voiture à chez eux. Surtout auront-ils le sentiment de vivre dans une grande cité plutôt que dans ce « trou » campagnard.
En m’approchant, je ne peux que constater que tout est à l’avenant, parfaitement prévisible : des châssis en mauvais aluminium qui vieillissent mal, des portes rudimentaires et malmenées, des halls aseptisés mais néanmoins crasseux, des rangées de boîtes aux lettres, dont les portes sont arrachées…
On aura beau dire que ce sont là des propositions révolues, qu’aujourd’hui on ne ferait plus cela, que les techniques de construction ont évolué, de même que les modèles d’urbanisme, et que, bien sûr, on changerait tout si on en avait les moyens financiers… le fait est que ce lieu continue à exister et à être occupé. Même s’ils sont entretenus – de façon superficielle –, les immeubles et leurs abords se dégradent et sont habités tels quels. La pauvreté doit accepter de se loger dans un passé déglingué. Et de cette déglingue, on lui signifiera évidemment qu’elle est responsable.
L’esprit de ce lieu est fait de violence, d’une violence sociale conjointe à la violence faite au lieu lui-même. La cité au milieu des prés est une absurdité. Comme si nous pouvions déposer n’importe quoi n’importe où. Un quartier sans passé, surgi de rien, indifférent au contexte où il a été bâti, peut-il vieillir autrement que mal ? Étrangère à son paysage, cette cité respire l’exclusion dans sa conception même : une poche urbaine abandonnée dans les champs.
Comment peut-on vivre ici, sinon avec le sentiment d’être mis à l’écart ? Sans doute, certains ont tenté de s’approprier les lieux et de faire de cet ici leur chez soi, en mettant des fleurs aux fenêtres, en choisissant des tentures colorées… Force est de reconnaître que beaucoup d’entre eux laissent tout aller, que les parties communes sont négligées, parfois même vandalisées. Héritiers d’une mise à l’écart et qui plus est d’un cadre de vie dégradé, comment pourraient-ils se comporter autrement qu’en exclus et ne pas faire subir à leurs lieux de vie la violence qu’ils y subissent ? « La destructivité est la créativité du pauvre. »[1]
René Char avait beau dire que « notre héritage n’est précédé d’aucun testament »[2], nous vivons tous dans l’héritage de lieux qui orientent nos modes de vie. Et bien plus encore, ceux qui n’ont ni les moyens financiers ni les ressources culturelles pour construire, pour rénover ou pour partir. En l’absence même de testament, cet héritage est un destin.