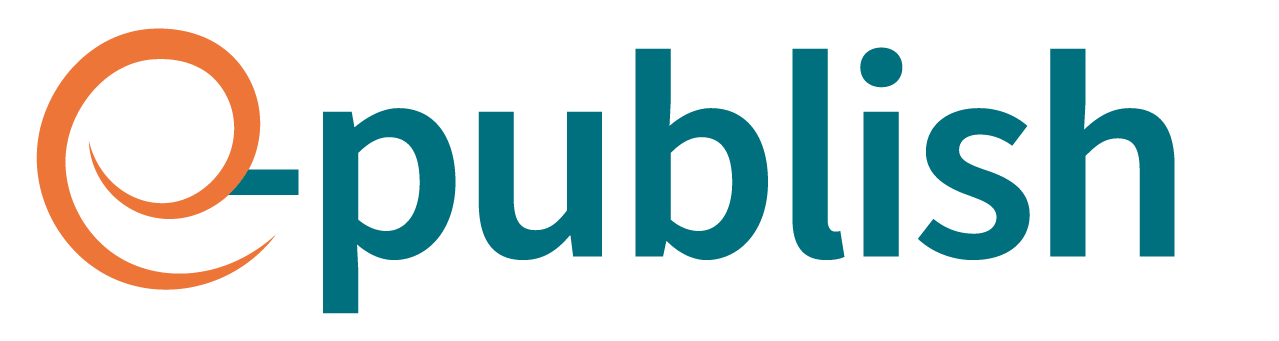9a. L’échangeur de l’absence
Les échangeurs sont-ils quelque part ? Certes, à la croisée de deux autoroutes et situables sur une carte. Mais, quand nous y sommes, où sommes-nous ? Tout entiers absorbés par notre rotation, le regard rivé sur la circulation devant et derrière nous, et sur les embranchements à ne pas manquer. Le contexte latéral tend à s’effacer de notre esprit. Il reste des réverbères, quelques touffes de végétaux et parfois un bâtiment au loin. Nous les remarquons à peine.
Je me targue d’avoir le sens de l’orientation, mais dans cet échangeur comme dans bien d’autres, je le perds. Je tourne tellement sur moi-même que je ne sais plus où est le Nord, où est le Sud, où sont la gauche et la droite. Ai-je pris la bonne bifurcation ? Suis-je parti dans la bonne direction ? Dans l’immédiat, il ne me reste qu’à continuer tout droit, c’est-à-dire poursuivre le tournant jusqu’aux prochaines indications.
Usager régulier des lieux, je devine à l’arôme de café que je suis bien à proximité de l’atelier de torréfaction. Insituable, comme toute odeur, elle ne m’indique rien sur mon chemin. J’ai bien quelques repères – un hangar, un show-room, un pylône – qui me confirment que je suis dans le bon, mais, pour l’essentiel, je navigue à vue, au gré des panneaux indicateurs. Eux seuls, ou mon GPS, me garantissent mon orientation. Le paysage autour de moi tourne sur lui-même. Je ne peux y prêter attention, il est trop instable, et je dois surtout me concentrer sur l’avant et l’arrière. Je ne suis que dans ma conduite.
« Un monde frontal », dit Marc Desportes pour décrire la perception des autoroutes et en particulier celle des échangeurs[1]. Le conducteur, du fait même de sa vitesse, est contraint à réduire sa perception rien qu’à l’avant et à l’arrière. La latéralité en est exclue. Le paysage s’en trouve raboté.
Nous connaissons tous ces trajets, en voiture comme en d’autres moyens de transport, où nous ne faisons que nous déplacer d’un point à un autre, dans la géographie mais non dans le paysage. Nous sommes absents aux lieux que nous parcourons, absorbés par la situation qui nous attend, la musique que nous avons programmée ou l’arrière-plan de nos rêveries. Les lointains ne sont pas ceux que nous avons sous les yeux mais, au-delà d’eux, notre destination ou bien un ailleurs fantasmé et aléatoire. À l’occasion, nous jetons un œil distrait et étranger au paysage, comme si nous le survolions. Nous ne sommes surtout pas « ici », présents à ce qui nous est tout proche. « Ici » en l’occurrence n’est qu’un point sur notre trajet, qui détermine le temps qu’il nous reste à parcourir.
Depuis un demi-siècle, notre « sur-modernité » génère ce type d’espaces[2], destinés à une mobilité accrue. Ils vont de pair avec un certain imaginaire : un besoin effréné d’immédiateté, un désir irrépressible de connectivité, une passion illimitée d’abolir toute distance… Le « local » en est exclu, y représente une idéologie réactionnaire, ou, au mieux, une curiosité anecdotique. Le monde y est pris dans la ronde d’un grand réseau, où tout semble à portée de main et dont la finalité consisterait à tourner sur elle-même, en produisant de la richesse dans son tourbillon.
Où suis-je donc dans cet échangeur ? Ni ici ni là-bas, ni dans le proche ni dans les lointains. Nulle part, si ce n’est dans un espace de temps qui me sépare de mon rendez-vous.